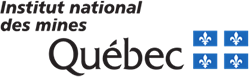Parcours d'une passionnée de la géologie et enseignante-chercheuse à Alès, Noémie Fayol

Ayant séjourné quelques années au Québec afin d’obtenir un doctorat à l’Université du Québec à Montréal en géologie, Noémie Fayol réside dans son pays natal, la France, à Alès dans la région Occitanie. Sa passion de la géologie lui vient de son grand-père qui l’a initié dès son jeune âge à cette science qui s’intéresse à mieux comprendre les processus terrestres. Parcours d’une collaboratrice de l’Institut national des mines et enseignante-chercheuse œuvrant au sein d’une école au rayonnement international, l’École nationale supérieure des mines d’Alès (IMT Mines Alès).
Une enseignante-chercheuse qui fait sa place
Enseignante-chercheuse, Noémie Fayol œuvre depuis septembre 2018 à l’IMT Mines Alès, une école des mines fondée il y a 177 ans et qui a pour mission initiale de former des cadres pour l'industrie minière. Les activités de formation et de recherche de l’IMT Mines Alès sont réparties dans 6 domaines d’excellence : génie civil et bâtiment durable, matériaux innovants et écologiques, informatique et intelligence artificielle, industrie du futur, environnement, énergie et risques et ressources minérales. Mme Fayol agit à titre d’enseignante-chercheuse au sein du département d’ingénierie du sous-sol et exploitation minière. Elle touche entre autres aux enjeux des ressources minérales, aux ressources minérales et à l’exploitation des mines et des carrières à l’intérieur de ses cours. Elle initie également les étudiants de 1ère et 2e années aux enjeux des ressources minérales dans les territoires.
Mme Fayol dispense un total d’environ 100 heures d’enseignement par année et l’autre partie de son travail consiste à effectuer de la recherche avec le laboratoire de génie de l’environnement et son équipe pluridisciplinaire. L’essentiel de ses projets, elle les effectue en partenariat avec des chercheurs provenant d'autres écoles comme celle de Paris et celle de Nancy, notamment en passant par la Chaire de Recherche et Formation Industrie Minérale & Territoires. Cela lui permet de constater les interactions entre l’industrie minière et les territoires d’implantation. Cette chaire de recherche est financée par l’État, par des compagnies minières ainsi que par des associations. « En France, avant même de faire du terrain, le géologue est appelé à être en contact direct avec la population et à réaliser des relations publiques. Il agit donc comme premier interlocuteur de terrain avec les communautés. L’enjeu de l’intégration des projets dans les territoires est considéré », explique Mme Fayol.
Séjour au Québec
Mme Fayol a fait un séjour à l’Université Laurentienne pour une session puis au Québec avec un stage de 8 mois de fin d’études au sein d’une compagnie d’exploration. Détentrice d’un doctorat à l’Université du Québec à Montréal, sa thèse s’intitulait « Les minéralisations aurifères associées aux intrusions alcalines néoarchéennes de la sous-province de l’Abitibi, Canada. Exemple de la mine d’or Lac Bachelor, Abitibi – Modèle génétique et guides d’exploration ». Cette thèse visait à répondre aux enjeux sur l’origine de l’or. D’ailleurs, sa thèse s’est effectuée aux tous débuts de l’actuelle Mine Canadian Malartic en Abitibi-Témiscamingue. Parallèlement à son doctorat, elle a œuvré à titre d’assistante sur certains cours universitaires qui traitaient des gîtes minéraux. De plus, Mme Fayol a obtenu des contrats lors de son doctorat pour des compagnies minières comme la Société québécoise d’exploration minière (SOQUEM). Elle tentait d’obtenir des contrats en lien le plus possible avec ses sujets de recherche, lui permettant ainsi de visiter des sites miniers et d’échanger directement avec le personnel de terrain. De plus, elle a réalisé des études de terrain et des analyses en géochimie, en géophysique appliquée à l’exploration, et en modélisation physique. Ce projet a été réalisé en partenariat avec le Canadian Mining Innovation Council (projet CRSNG-CMIC Footprints) et Ressources Métanor Inc. Une fois sa thèse terminée, elle fait le choix de retourner s’installer en France.
Inspirée par les travaux de l’Institut national des mines
Le matériel de recherche du Portrait numérique de l’industrie minière au Québec, réalisé par l’Institut national des mines et ses partenaires, a permis de soutenir l’équipe du projet Mines du futur de la Nouvelle-Calédonie dont Mme Fayol fait partie. Elle a ainsi, avec ses collaborateurs, produit le Portrait des compétences numériques des personnels de l’industrie minière en Nouvelle-Calédonie. La méthodologie utilisée, par l’Institut national des mines et ses partenaires à l’intérieur du portrait, a su inspirer grandement la Nouvelle-Calédonie. Un webinaire virtuel s’est d’ailleurs déroulé en septembre 2020 présentant à la fois les résultats de recherche des deux organisations, et ce, devant des intervenants du secteur minier et de l‘éducation en Nouvelle-Calédonie. Plusieurs constats se dégagent de cette étude : l’envie d’innovation dans le secteur minier est palpable; les capacités numériques du personnel ne sont pas utilisées à leur plein potentiel et le niveau d’études et l’âge sont deux facteurs clés permettant d’influencer la perception que le personnel a de ses propres compétences numériques. Comme au Québec, les principaux freins à utiliser le numérique sont la peur du manque de contact humain, la réticence au changement et le manque de temps pour s’approprier de nouveaux outils.
Quelques constats
Mme Fayol soulève qu’il est intéressant au Québec de retrouver à la fois des mines modernes et des mines plus traditionnelles. Elle souligne que le secteur est très dynamique et qu’il est bien ancré dans la culture québécoise. Selon elle, la profession de géologue est bien connue au Québec tandis qu’en France, il lui arrive souvent de devoir expliquer sa profession. Elle ajoute qu’au Québec, les normes environnementales sont très importantes. De plus, elle souligne également que les étudiantes et étudiants en géologie possèdent le grand avantage d’effectuer leur stage dans les mines et de gagner de l’expérience lors de leur emploi d’été.
Mme Fayol clame haut et fort avoir adoré son expérience au Québec et trouve intéressant qu’à l’université les groupes ne soient pas homogènes en termes d’âges et d’expériences. Elle poursuit sa collaboration avec le Québec avec ses projets de recherche.