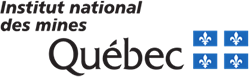La formation des géologues au Québec et le marché de l'emploi
Pour découvr le baccalauréat en géologie!
Doté d’un territoire immense et d’un potentiel minéral exceptionnel, le Québec est depuis longtemps une destination de prédilection pour l’industrie minière.
La découverte et l’exploitation d’une mine requièrent l’expertise de nombreux corps de métier, chacun nécessitant un niveau d’études spécifique. À cet égard, les établissements d’enseignement publics offrent une formation de grande qualité aux gens désirant œuvrer dans ce domaine. De plus, le contexte sociopolitique particulier du Québec permet d’offrir toute la gamme de la formation reliée aux mines dans les deux langues officielles du Canada, le français et l’anglais.
Au fil du temps, le Québec est devenu une référence en termes de formation minière. Le texte qui suit est consacré à la formation des géologues. Nous présentons en introduction le cheminement scolaire particulier au Québec. La figure 1 permet d’identifier les différences et les similarités entre les systèmes d’éducation français et québécois menant à l’obtention d’un diplôme en géologie. Nous présentons ensuite les programmes de collaboration universitaire qui existent entre la France et le Québec pour la formation des géologues.
La section suivante porte sur le marché du travail et les perspectives d’emplois. Cette section s’appuie en grande partie sur une analyse de données publiques relatives au taux de placement des jeunes géologues. Elle met en lumière la relation significative entre le taux d’emploi et l’aspect cyclique des investissements miniers.
Le cheminement scolaire pour devenir géologue
Pour accéder à la formation universitaire en géologie, l’étudiant québécois doit terminer avec succès deux années d’études collégiales, ce qui porte à 13 le nombre total d’années d’études depuis le début du primaire (Fig. 1). Les études collégiales préalables à l’université sont une particularité du système d’éducation québécois. Toutefois, cette caractéristique ne pose pas de contrainte particulière aux échanges entre la France et le Québec pour les études universitaires. En effet, l’accord franco-québécois sur la reconnaissance des diplômes et la validation des études, signé en 1996, a clairement établi une équivalence entre le baccalauréat français qui nécessite 12 ans d’étude et le diplôme d’études collégiales québécois complété en 13 ans. Il est donc possible, avec l’un ou l’autre de ces deux diplômes, d’accéder au premier cycle d’études universitaires en France comme au Québec (MICCQ, 2005).
Figure 1 : Système d’éducation au Québec
Au Québec, sur les 19 établissements universitaires (MEES, 2018), quatre donnent la formation en géologie. L’Université du Québec à Chicoutimi, l’Université du Québec à Montréal et l’Université Laval offrent cette formation en français tandis que l’Université McGill l’offre en anglais. À l’exception notable de l’Université du Québec à Chicoutimi, la formation universitaire en géologie est offerte dans deux grands centres urbains, Montréal et Québec. Par comparaison, la formation minière de niveau collégial qui mène à un diplôme technique est dispensée beaucoup plus largement dans les établissements d’enseignement répartis sur l’ensemble du territoire québécois. Finalement, la formation minière qui mène à un métier spécialisé en mécanique industrielle, en forage, en extraction ou en traitement de minerai est offerte exclusivement dans les régions minières, par ailleurs éloignées des grands centres urbains.
Plusieurs jeunes géologues approfondissent leur niveau de connaissance en poursuivant leurs études au deuxième et plus rarement au troisième cycle universitaire. Les études graduées au deuxième cycle durent deux ans et mènent à une maîtrise en géologie. Cette diplomation est souvent privilégiée par les géologues qui envisagent une carrière en exploration minière. Le diplôme de troisième cycle menant à un PhD en géologie exige encore trois années d’études additionnelles après la maîtrise. Les détenteurs de PhD en géologie visent essentiellement une carrière en recherche ou en enseignement.
La formation universitaire offerte au Québec dispose de la souplesse nécessaire pour s’adapter rapidement aux réalités changeantes du milieu de travail. Les programmes offerts comportent souvent une introduction aux avancées technologiques qui ont un impact sur la profession de géologue. L’utilisation de logiciels spécialisés pour la cartographie, le traitement des données géophysiques et géochimiques et la modélisation des gisements à partir de banques de données considérables fait maintenant partie de la formation de base des étudiants en géologie. Sur le terrain, les outils tels que le GPS et les drones facilitent les déplacements en milieu isolé tandis que les analyseurs portables fournissent rapidement une information pertinente à la prise de décision, notamment pour l’implantation de forages d’exploration et réduisent le nombre d’échantillons requis pour des analyses ultérieures. Même l’aspect administratif de la profession est modifié avec des innovations comme la désignation sur carte pour l’acquisition des titres miniers sur Internet (Jébrak et Vaillancourt, 2013).
La diplomation universitaire de premier cycle en géologie est aussi une condition préalable à l’admission à l’Ordre professionnel des géologues du Québec (OGQ). La réussite d’un examen spécifique à l’OGQ représente la dernière étape à franchir avant de pratiquer la géologie au Québec, l’adhésion à l’OGQ étant obligatoire.
La collaboration entre le Québec et la France pour la formation des géologues
Les programmes existant de collaboration entre le Québec et la France pour la formation des géologues favorisent nettement les études graduées de deuxième cycle. Chaque programme d’échange possède ses caractéristiques. Toutefois, dans la plupart des cas un effort particulier est consacré au volet pratique de la formation, essentiel à l’apprentissage de jeunes géologues qui travailleront principalement sur le terrain au début de leur carrière.
Deux composantes distinctes du réseau de l’Université du Québec sont impliquées dans les exemples qui suivent. Le premier d’exemple est celui de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) qui accueille des étudiants français pour l’École d’été de géologie de terrain depuis maintenant 11 ans, en collaboration avec l’Université de Lorraine et avec la Direction générale de la géologie du Ministère des Ressources naturelles du Québec. L’École débute avec un cours intensif crédité par l’UQAT. D’une durée de deux semaines, ce cours présente les particularités géologiques du Québec minier aux étudiants de niveau master 1 et master 2, sélectionnés parmi plusieurs universités françaises. Par la suite, chaque étudiant effectue un stage en entreprise d’une durée approximative de quatre mois, reconnu par son université d’attache. L’expérience démontre que cette formule favorise nettement le démarrage des carrières des jeunes géologues français intéressés par l’exploration minière.
Par ailleurs, l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et l’UniLasalle offrent conjointement depuis 2014 un programme d’échange qui permet aux étudiants français d’obtenir une double diplomation, le diplôme d’ingénieur émis par l’UniLasalle et la maîtrise en géologie ou en génie géologique profil professionnel, émis par l’UQAC. Cette formation d’une durée de 12 mois comprend un volet théorique de niveau gradué dispensé par les professeurs de l’UQAC, un volet pratique dispensé par des professionnels de l’industrie, une formation sur le terrain au Québec (en Abitibi-Témiscamingue) et au Nevada ainsi qu’un stage en entreprise d’une durée de 3-4 mois.
Il existe aussi d’autres programmes d’échanges, comme celui entre l’UQAM et l’Université d’Orléans, qui permettent aux étudiants à la maîtrise de faire un trimestre à l’étranger. Les cours complétés sont reconnus pour l’obtention du diplôme. Par contre, ces échanges relèvent de démarche individuelle de la part de l’étudiant et concernent uniquement les cours magistraux.
Le marché du travail et les perspectives d’emplois
Les emplois des géologues qui travaillent en exploration minière sont susceptible d’être affectés par les variations cycliques des investissements miniers. Afin de documenter cette tendance, nous utilisons les données publiques provenant de la relance effectuée par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). La relance documente la situation des jeunes diplômés deux ans après l’obtention de leur diplôme. Par conséquent, la relance de 2001 évaluait la situation des gradués de 1999 et celle de 2015 la situation des gradués de 2013.
La figure 2 présente sous forme de pourcentage, la proportion d’étudiants gradués entre 1999 et 2013 ayant intégré le marché du travail deux ans après l’obtention du Baccalauréat en géologie. Ces données sont juxtaposées à la courbe des investissements miniers annuels pendant cette période de 15 ans (ISQ, 2018). La figure 2 précise également la proportion de jeunes gradués en géologie qui poursuivaient alors leurs études ou qui étaient en recherche d’emploi. À trois reprises, le pourcentage total pour une année donnée est moindre que 100 %, certaines personnes interrogées n’étant alors ni en emploi, ni aux études, ni en recherche d’emploi.
Figure 2 : Investissements miniers vs jeunes géologues au travail, aux études ou en recherche d’emploi
La proportion de jeunes géologues en emploi deux ans après leur diplomation varie entre 40 et 55 %. Nous interprétons le maximum de 55 % atteint en 2013 comme une conséquence des investissements miniers considérables consentis pendant les années précédentes, le maximum des investissements miniers annuels pendant la période considérée ayant été engagé en 2011. Un décalage d’environ 2 ans est donc perceptible entre le maximum des investissements miniers annuels en 2011 et la proportion maximale des jeunes géologues en emploi tel que mesuré par la relance en 2013 qui témoigne d’une période d’emploi particulièrement favorable.
La figure 2 montre également que la proportion d’étudiants qui choisissent de poursuivre leurs études après l’obtention du baccalauréat fluctue énormément d’une année à l’autre. La grande variation observée, entre 25 et 56 %, semble également en lien et en décalage avec les investissements miniers annuels. Nous constatons que les investissements à la baisse favorisent la poursuite des études graduées. Inversement, des investissements miniers à la hausse entraînent une diminution de l’attrait d’une formation universitaire de deuxième cycle. Le décalage observé s’explique sans doute par la durée des programmes d’études universitaires.
Ce décalage entre une augmentation des investissements miniers annuels et une proportion moindre d’étudiants en géologie aux cycles supérieurs est nettement perceptible dans les données couvrant la période qui va de 2005 à 2009, et dans celles qui s’étalent de 2011 à 2013. En effet, l’augmentation des investissements de 2005 à 2007 se reflète dans la baisse des inscriptions mesurée en 2009. Cette hypothèse du décalage entre le cycle minier et le nombre de personnes poursuivant leur étude est appuyée également par les années suivantes. En 2011, la proportion de jeunes poursuivant leurs études après le baccalauréat atteignait 56 %. Deux ans plus tard, elle diminuait de moitié, à 25 %, ce qui reflète le marché florissant de l’emploi en 2011 et 2012. Par la suite, en 2015, l’attrait pour des études graduées était à nouveau à la hausse, une conséquence de la baisse constante des investissements miniers annuels depuis 2011.
Le lien entre les investissements miniers annuels et la proportion de géologues en recherche d’emploi est encore plus direct et immédiat. Il n’y a aucun décalage. De 2001 à 2009, le taux de chercheurs d’emplois est à la baisse tandis que les investissements sont à la hausse, la période de 2009 à 2011 représentant un épisode de plein emploi alors que les investissements miniers annuels dépassaient 294 millions de dollars canadiens, le seuil critique représenté par la médiane des investissements annuels. La proportion de jeunes géologues en recherche d’emploi augmente à nouveau à compter de 2013 alors que les investissements annuels diminuèrent en deçà de ce seuil critique. En 2015, la forte proportion de jeunes géologues qui poursuivaient leurs études après le baccalauréat influence le nombre de chercheurs d’emploi dans une période de faibles investissements.
La relance documente également le type d’emploi occupé par les jeunes géologues deux ans après leur diplomation. La figure 3 présente la proportion de jeunes diplômés en géologie qui occupait un travail à temps plein ainsi que la proportion de ces géologues dont l’emploi était alors directement lié à leur formation en géologie. La courbe des investissements miniers annuels utilisée précédemment est reproduite également sur cette figure.
Figure 3 : Investissements miniers et emplois des diplômés du Bac en géologie
L’influence des investissements miniers sur le type d’emplois disponibles aux jeunes géologues est indiscutable. Ainsi, la période de 2001 à 2005 marquée par un creux des investissements miniers annuels est une période où les jeunes diplômés en géologie travaillaient en forte proportion dans d’autres domaines. L’année 2005 est particulièrement éloquente alors que seulement 55 % des jeunes géologues occupaient en emploi en lien avec leur formation. Par ailleurs, pendant 6 ans à compter de 2007, à la suite d’une augmentation significative des investissements miniers annuels au-dessus du seuil critique, près de 90 % des jeunes géologues qui occupaient un emploi travaillaient en géologie.
Estimation des besoins de main-d’œuvre
Depuis 2010, l’Institut national des mines du Québec (INMQ), la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) et Services Québec, réalisent conjointement avec la Table jamésienne de concertation minière (TJCM) une évaluation prévisionnelle des besoins de main-d’œuvre pour l’industrie minière sur un horizon de cinq ans. Cette étude prévisionnelle est mise à jour tous les deux ans. Les estimations de besoin de main-d’œuvre qui en découlent prennent en considération plusieurs éléments, particulièrement l’ouverture et la durée de vie des mines ainsi que la mobilité de la main d’œuvre.
Les plus récentes estimations des besoins de main-d’œuvre pour l’industrie minière couvrent la période 2017-2021. Elles démontrent que 66 % des postes à pourvoir pendant cette période exigeront à l’entrée en fonction un diplôme d’études professionnelles, 13 % une formation collégiale et 7 % une formation universitaire (CSMO, 2017). Une certaine proportion d’emplois offerts sur les sites miniers, 14 %, n’exigeant aucun diplôme à l’embauche.
Les géologues comptent parmi les postes les plus nombreux nécessitant une formation universitaire. En nombre absolu, 135 postes de géologue seront à pourvoir au Québec entre 2017 et 2021, dont 85 pour satisfaire aux besoins spécifiques de la région Nord-du-Québec. À titre d’information complémentaire, entre 2012 et 2015, 141 étudiants ont diplômé en géologie dans les quatre universités offrant le programme. De ce nombre, environ 46 % ont poursuivi leurs études aux cycles supérieurs (voir figure 2). De plus, certains jeunes diplômés font le choix de travailler hors Québec ou dans un autre secteur d’activité. Par conséquent, nous estimons que le risque de pénurie de main-d’œuvre en géologie au cours des 5 prochaines années est élevé.
Conclusion
L’accord franco-québécois sur la reconnaissance des diplômes et la validation des études, signé en 1996, permet aux étudiants français et québécois de poursuivre leurs études universitaires en géologie aussi bien en France qu’au Québec.
Les programmes d’échanges actuels entre les établissements universitaires français et québécois favorisent les études graduées. Ils offrent des opportunités concrètes aux étudiants français de parfaire leur formation sur le terrain, par des stages en entreprises. La diversité géologique du territoire québécois permet aussi aux jeunes géologues français d’intégrer rapidement le marché du travail et d’acquérir une première expérience professionnelle dans des terrains anciens, archéens et protérozoïques, dont le potentiel minéral est encore méconnu. Ces échanges offrent donc l’occasion à de jeunes géologues d’établir tôt dans leur carrière des contacts professionnels structurants pour l’avenir.
Au fil des ans, l’offre d’emplois en géologie est affectée par la cyclicité des investissements miniers annuels. Lorsque les investissements miniers annuels n’atteignent pas le seuil du plein emploi, les jeunes bacheliers favorisent la poursuite de leurs études aux cycles supérieurs. Toutefois, selon l’estimation des besoins de main d’œuvre la plus récente, plus d’une centaine de postes en géologie seront à pourvoir dans les régions minières du Québec au cours des cinq prochaines années, ce qui est de bon augure pour débuter prochainement une carrière en géologie.
Références
CSMO 2017. Estimation des besoins de main-d’œuvre du secteur minier au Québec : 2017-2021 avec tendances 2027. Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des mines. Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Bibliothèque nationale et Archives Canada. 60 p.
Immigration et communautés culturelles Québec (MICCQ), (2005). France : Guide de comparaison des études avec le système éducatif du Québec. Ministère de l’immigration et des communautés culturelles du Québec. 22 p.
Institut de la statistique du Québec (ISQ), 2018. Répartition des dépenses en travaux d’exploration et de mise en valeur selon la substance recherchée, Québec, 2017. En ligne consulté 12 avril 2018
Jébrak, M., Vaillancourt, J., 2013. 100 innovations dans le secteur minier. En ligne consulté 12 avril 2018
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), (2016). La relance à l’université/2015 : La situation d’emploi de personnes diplômées – Enquête de 2015. En ligne consulté 26 mars 2018
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), (2018). Liste des établissements universitaires. Education.gouv.qc.ca. En ligne consulté 15 janvier 2018